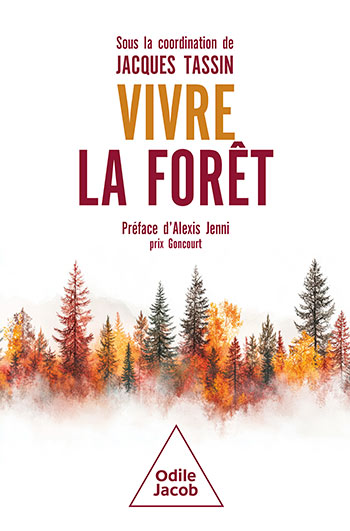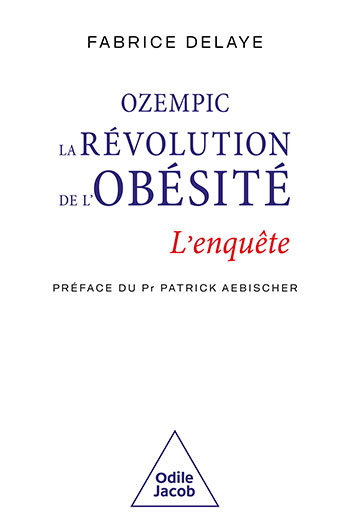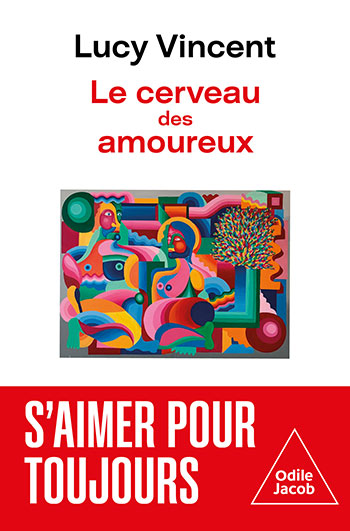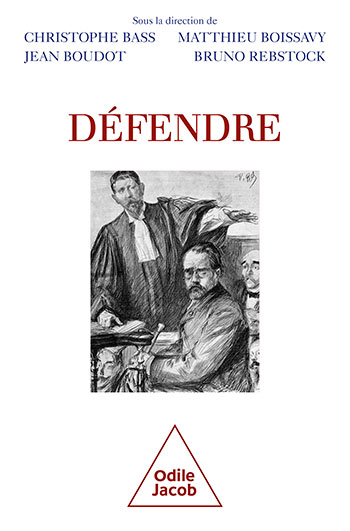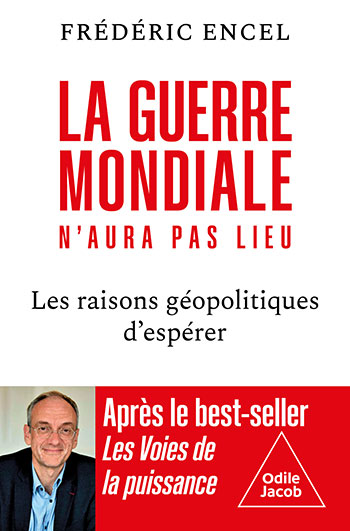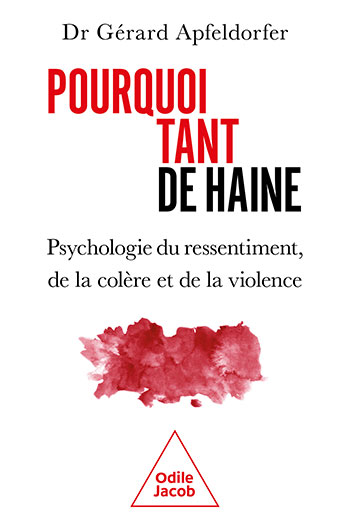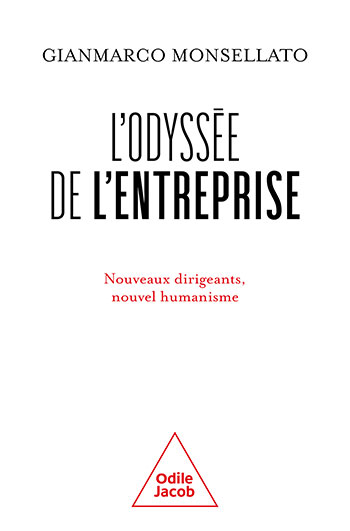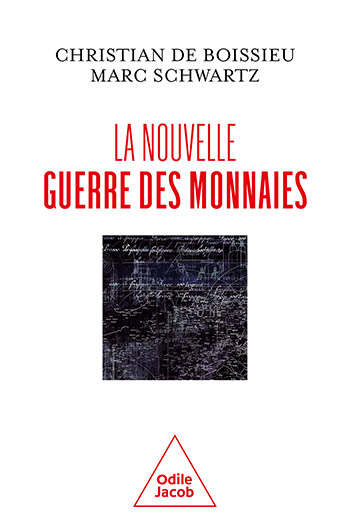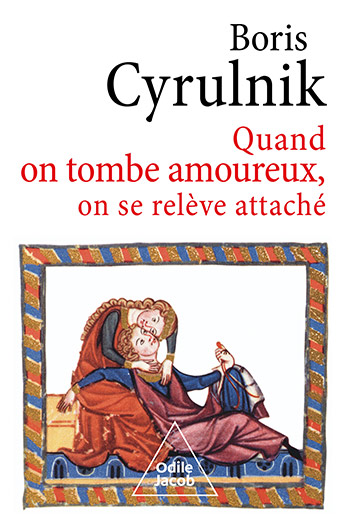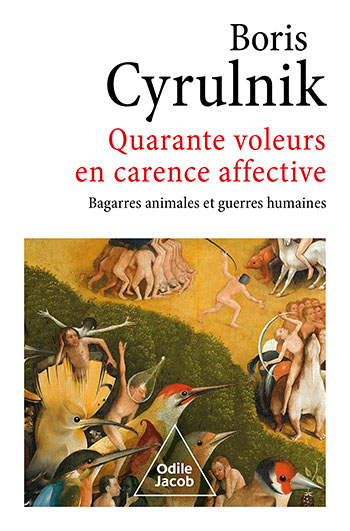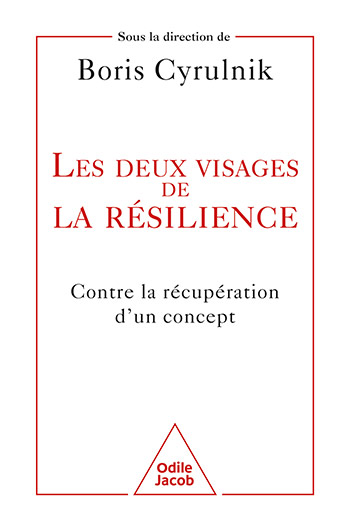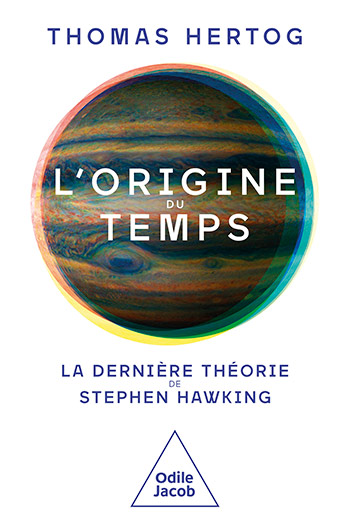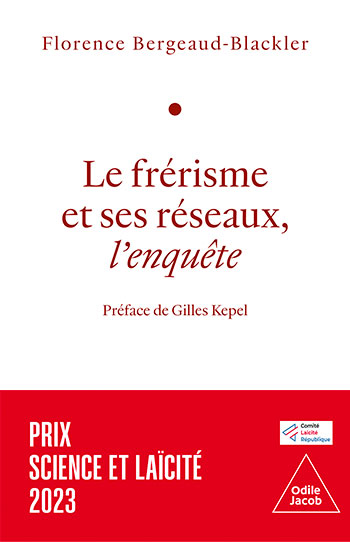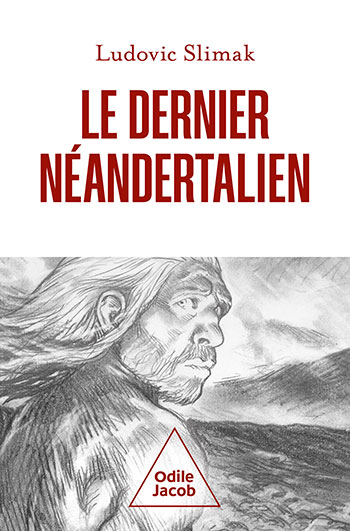La situation que nous vivons aujourd'hui en Europe et aux États-Unis est inédite. Au deuxième trimestre 2020, il va apparaître un effondrement de l'activité économique (le PIB pourrait baisser de 30%). Il ne s'agit pas d'une crise habituelle, où le recul de l'activité vient du recul de la demande de biens et services mais d'une perte de production due à l'impossibilité où se trouvent beaucoup de salariés d'aller travailler.
L'essentiel pour les politiques économiques n'est donc pas de soutenir la demande (même s'il faut bien sûr maintenir le revenu des salariés) mais d'empêcher que cette crise brutale mais normalement courte se transforme en une crise durable. Pour cela, l'essentiel est d'éviter les évolutions irréversibles qui affaibliraient les économies dans le futur, la première d'entre elles étant les faillites d'entreprises. Si une entreprise fait faillite, son capital, ses produits, ses emplois sont perdus et il y a perte durable de production.
Tous les gouvernements, en Europe, aux États-Unis, ont bien compris qu'il fallait absolument empêcher les faillites, et ont mis en place les mesures nécessaires : garanties publiques des crédits bancaires, achats d'obligations d'entreprises par les Banques Centrales, prise en charge des salaires par l'Etat, report des impôts et d'autres charges, subventions aux secteurs et aux entreprises les plus en difficulté... On peut donc effectivement espérer qu'avec ces politiques la hausse des faillites sera freinée.
Mais le problème est que le coût pour les Etats de cette politique où ils prennent en charge les dépenses des entreprises est très élevé : le déficit public pourrait atteindre 6% du Produit Intérieur Brut dans la zone euro et 14% aux États-Unis. Sans intervention des Banques Centrales, des déficits publics aussi élevés seraient difficiles à financer, même pour les pays les plus sûrs (États-Unis, Allemagne), et on a bien vu initialement la hausse des taux d'intérêt à long terme de ces pays.
Mais rapidement, la Réserve Fédérale et la BCE ont décidé de monétiser ces déficits publics, c'est-à-dire d'acheter les émissions de dette publique correspondantes contre création monétaire. Il faut comprendre que cette décision fait disparaître tout problème de financement, tout risque de perte de solvabilité budgétaire ou de crise des dettes publiques.
En effet, une dette publique irréversiblement achetée par une Banque Centrale est de facto annulée. D'une part, les Banques Centrales reversant leurs profits aux Etats, les intérêts sur la dette publique versés par l'Etat à la Banque Centrale sont rendus par la Banque Centrale à l'Etat : la dette publique achetée par la Banque Centrale devient donc gratuite pour l'Etat. D'autre part, si la Banque Centrale s'engage à ne jamais réduire dans le futur la taille de son bilan, à l'échéance d'une obligation souveraine achetée, elle achètera une autre obligation, et l'Etat n'aura jamais à rembourser.
Une obligation d'un Etat gratuite et non remboursable a bien été de fait annulée. On peut donc penser qu'on a trouvé un « free lunch » : les gouvernements peuvent mener des politiques budgétaires ultra expansionnistes face à cette crise sans aucun coût, sans aucune difficulté, puisque les dettes publiques sont achetées (monétisées) par la Banque Centrale.
Il faut d'abord ajouter une première réflexion. Si un seul pays menait cette politique, accroissait considérablement la quantité de monnaie créée par la Banque Centrale pour acheter les dettes publiques émises par l'Etat, la perte de confiance dans la solidité de la monnaie de ce pays, avec l'explosion de l'offre de monnaie, provoquerait des sorties de capitaux, les résidents du pays transférant leur épargne dans d'autres devises, et l'effondrement du taux de change du pays.
Mais aujourd'hui, tous les pays de l'OCDE (Etats-Unis, zone euro Royaume-Uni, Japon...) mènent cette même politique : un Européen n'a pas de raison de vendre des euros pour acheter des dollars, la Réserve Fédérale menant aussi une politique monétaire extravagante.
Y a-t-il un coût à cette politique, qui permet de stabiliser les entreprises face à la crise du coronavirus sans dégrader la solvabilité budgétaire des Etats et sans conduire à une crise de change si elle est menée partout ? La question est une question centrale pour la macroéconomie contemporaine : quelle est la limite à l'augmentation de la taille du bilan d'une Banque Centrale ? La réponse normale est la suivante : la limite est atteinte quand les agents économiques d'un pays perdent confiance dans la valeur de la monnaie, et s'en débarrassent pour acheter soit des biens, soit des actifs refuge : or, immobilier, cryptomonnaies... Dans le premier cas, il y a inflation, dans le second cas, hausse violente des prix de ces actifs. Mais au Japon, le bilan de la Banque Centrale représente 105% du PIB, plus de trois fois plus que dans la zone euro ou aux Etats-Unis, et on n'a pas vu de perte de confiance dans le yen.
Il y a peut-être vraiment « free lunch » avec cette politique de monétisation généralisée des dettes publiques.
Patrick Artus est professeur associé à l'École d'économie de Paris et chef économiste de Natixis.
Dernier ouvrage publié : Discipliner la finance (mai 19)
[ Idées pour aujourd'hui et pour demain ]
Patrick Artus
L'Intervention des banques centrales est-elle "un repas gratuit" (Un "free lunch") ?
Publié le 3 avril 2020