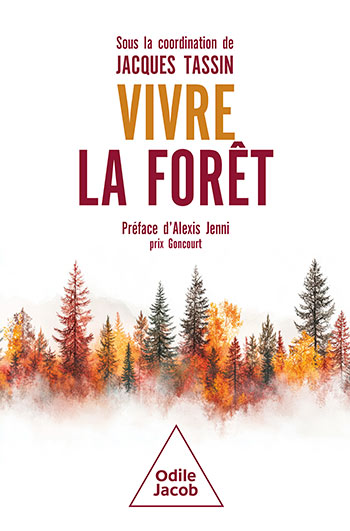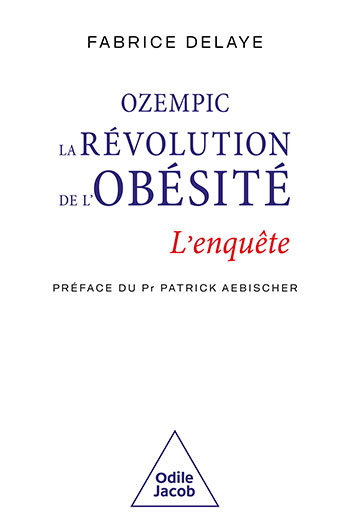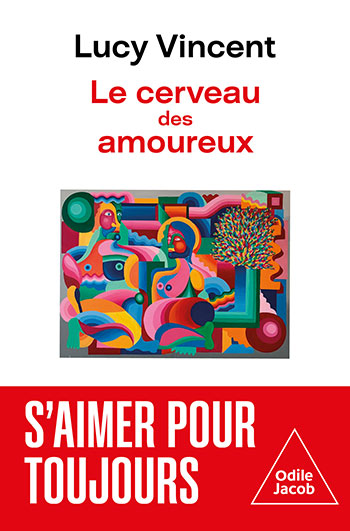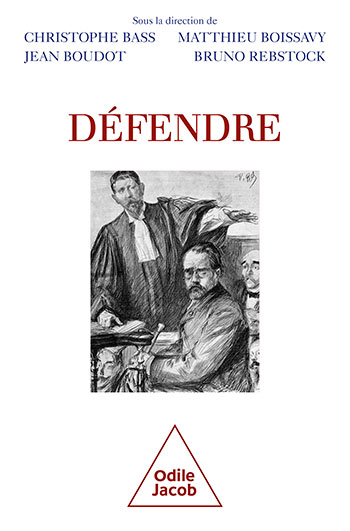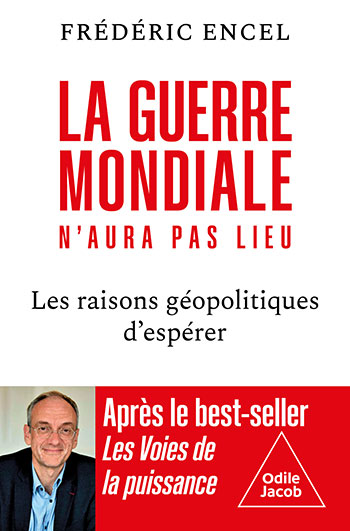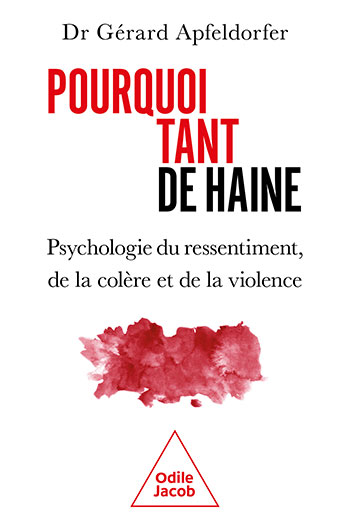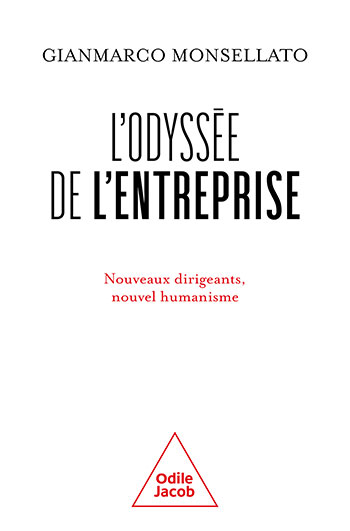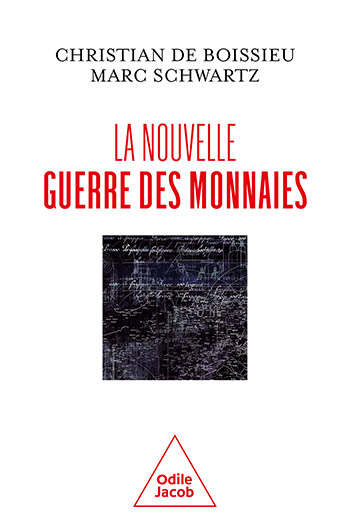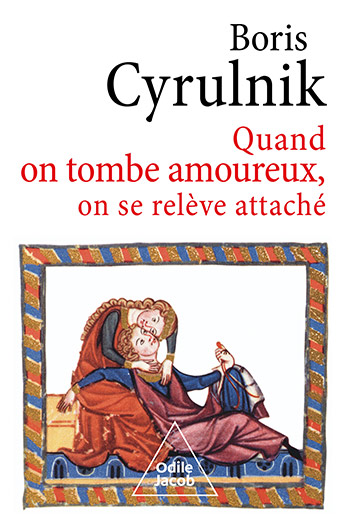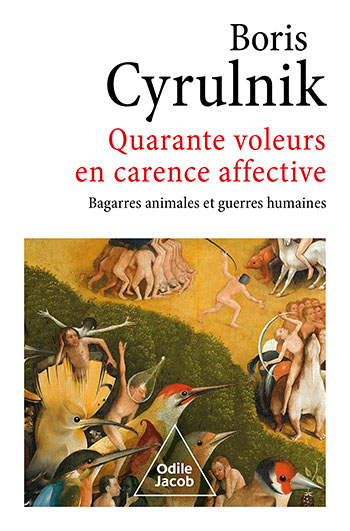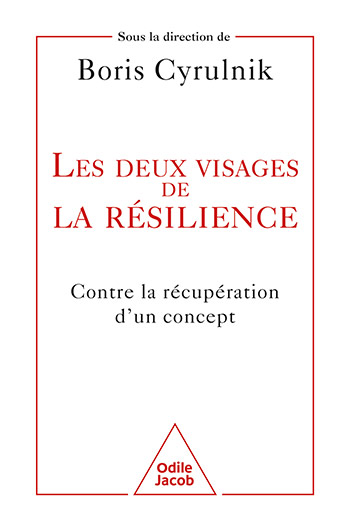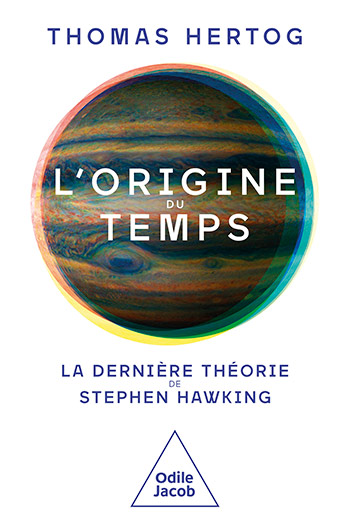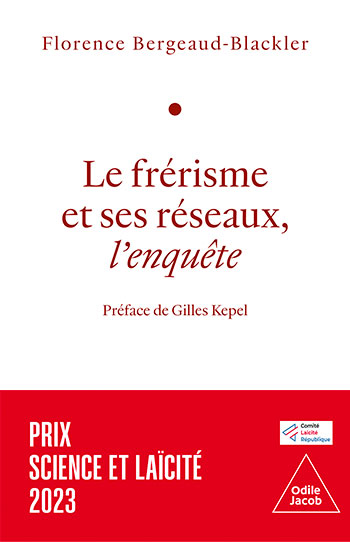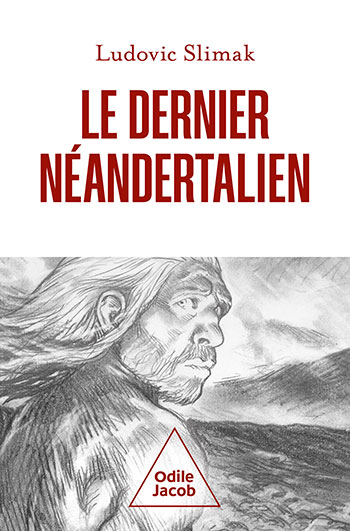La crise économique issue de la crise sanitaire ne fait qu’ajouter aux désordres persistants et rend d’autant plus nécessaire une révision de la théorie et de la politique économiques dont l’enjeu est de reconnaître l’instabilité intrinsèque des économies de marché mais aussi leur résilience qui dépend du contexte institutionnel qui les caractérisent.
La neutralité de l’État, l’efficience des marchés financiers, la flexibilité des marchés, à commencer par celui du travail, la stratégie des entreprises indexées sur leurs performances trimestrielles retenues par des actionnaires activistes sont autant de règles, censées garantir équilibre, innovation et croissance, que les crises successives ont fait voler en éclats. L’exigence d’une coordination, qui n’est plus réduite à l’autorégulation des marchés, resurgit. Et avec elle la nécessité de retrouver les temporalités propres aux principaux acteurs de cette coordination que sont les entreprises, les détenteurs de capitaux et les États.
Comment, dès lors, doit-on appréhender la crise économique particulièrement violente qui fait suite à la crise sanitaire ? Faut-il la considérer comme un événement exceptionnel et finalement comme une simple parenthèse faisant dévier temporairement de l’équilibre ? Ou faut-il y voir une perturbation supplémentaire venant compliquer un cheminement hors de l’équilibre ?
À ces questions répondent des discours convenus. En keynésiens de circonstance, certains ont imaginé que l’épargne forcée de ménages empêchés d’aller au travail pouvait se transformer en surconsommation une fois passée la période du confinement, assurant une reprise quasi immédiate de l’activité. Aux classiques impénitents, l’acceptation contrainte d’un surcroît important de dépenses et de dettes publiques est apparue comme devant être conditionnée à un usage d’urgence en gardant le souci de revenir vite à la sagesse comptable. Les plus radicaux défenseurs de l’environnement voient dans la crise sanitaire une validation de leur discours mais surtout une opportunité de le concrétiser en renforçant brutalement et rapidement règles et taxes comme si un nouvel équilibre, écologique celui-là, était à portée de main.
Ces discours ont un point commun : ils font l’impasse sur le temps nécessaire aux adaptations réussies dans un contexte d’irréversibilité et d’incertitude et, de quelque manière, ils se réfèrent à un monde d’après (qui n’est parfois que le monde d’avant) sans réellement se préoccuper des enchaînements étape après étape. (i) Avoir foi dans la conversion d’une épargne forcée en dépenses courantes fait l’impasse sur nombre d’obstacles. Les nombreuses destructions d’emplois et la décote des rémunérations du fait du chômage partiel vont se traduire par une chute du revenu global qui affectera durablement la demande, d’autant, évidemment, que le surcroît d’épargne (en même temps que la chute de revenus) est très inégalement réparti. L’incertitude des ménages quant à leurs revenus et à leurs emplois futurs ne peut que les conforter dans un comportement d’épargne de précaution. Les capacités de production sont limitées du fait des délais de rétablissement d’un taux normal d’activité, sans compter qu’elles ne pourraient pas absorber un surcroît de demande si d’aventure il y avait une désépargne massive. (ii) Imaginer que la nouvelle émission de dettes publiques n’est là que pour financer des dépenses exceptionnelles, non récurrentes, est non moins illusoire. Les besoins de soutien de la demande vont perdurer du simple fait de la chute durable du revenu des ménages. Les bouleversements attendus vont requérir des investissements importants tant publics que privés. En bref, dettes et besoins de financement du secteur privé seront durablement élevés rendant nécessaire un endettement public non moins durablement élevé sauf à faire fi d’enchaînements potentiellement catastrophiques. (iii) Revendiquer d’agir plus fort et plus vite en matière de transition écologique ne tient pas compte des destructions brutales de capital productif et d’emplois qui en seraient la conséquence, comme si les créations nouvelles pouvaient s’y substituer presque instantanément et sans coût excessif. Ce serait le plus sûr moyen, non seulement d’accélérer la spirale de la récession (voire de la dépression), mais aussi de discréditer l’objectif écologique auprès de la population.
C’est avec ces discours qu’il nous faut rompre. Les premières observations et analyses ne peuvent que nous convaincre que des ruptures importantes sont à attendre dès lors que les contraintes imposées dans l’urgence sur l’offre comme sur la demande s’inscrivent dans des contextes déjà marqués par des déséquilibres récurrents, vont affecter de manière différenciée et durable de nombreux secteurs de l’activité et impulser de nouveaux comportements tant du côté de l’offre que de celui de la demande. Une fois encore il n’y a pas lieu de dissocier le court du long terme tant les choix effectués étape après étape structurent un chemin qu’il faut se garder d’assimiler à la convergence vers un nouvel équilibre.
Aussi est-il nécessaire d’abandonner de dangereuses illusions, celle de l’optimisation immédiate des comportements et des résultats, celle de l’existence d’un équilibre général fut-ce-t-il un équilibre écologique que l’on pourrait atteindre rapidement et sans coût, celle de la table rase et d’une fin de l’histoire. Il convient bien plutôt de reconnaître, dans la crise actuelle, un nouvel épisode de l’évolution d’économies de marché intrinsèquement instables, mais aussi comme un moment privilégié d’en tester les conditions organisationnelles et institutionnelles de résilience.
Il est inutile d’imaginer que la crise actuelle ne sera rapidement qu’un mauvais souvenir. Il est dangereux de laisser croire que la suspension des règles de neutralité pourrait être temporaire tout en maintenant artificiellement un débat sur la durée plus ou moins longue de cette suspension. Mieux vaudrait considérer les choix requis en matière d’organisation des entreprises et de définition des politiques publiques, permettant à la fois de stabiliser l’économie et de la remettre sur le chemin du développement y compris dans la perspective de préserver l’environnement. La réalité est que les économies de marché sont multiples, mais qu’il est toujours possible d’introduire entre elles une ligne de partage suivant que les institutions qui les caractérisent garantissent ou non des adaptations lentes et graduelles, seules garantes de viabilité.
Ainsi, faire face à la crise rend d’autant plus nécessaire de plaider pour des entreprises conçues comme des coalitions entre les parties prenantes, pour une organisation bancaire et financière favorisant un capital patient, pour une organisation du travail privilégiant des emplois solides, pour des politiques publiques reposant sur des choix discrétionnaires évitant des embardées coûteuses et inutiles et centrés sur le soutien des dépenses productives.
Ces changements institutionnels et organisationnels doivent permettre aux entreprises de faire des anticipations fiables à long terme et de leur éviter un surendettement excessif et des faillites inutiles. Ils conduisent à reconnaître la nécessité d’un endettement public sans doute massif et durable, voire d’un financement monétaire des déficits publics. Ils doivent permettre d’orienter la dépense publique vers des investissements productifs et de s’assurer de programmes en la matière qui favorisent les investissements privés complémentaires des investissements publics. C’est grâce à de tels changements que la résilience sera au bout de l’épreuve.
Jean-Luc Gaffard, Professeur émérite à l’Université Côte d’Azur est co-auteur avec Mario Amendola et Francesco Saraceno de l’ouvrage Le Temps retrouvé de l’économie, Paris, Odile Jacob, 2020.