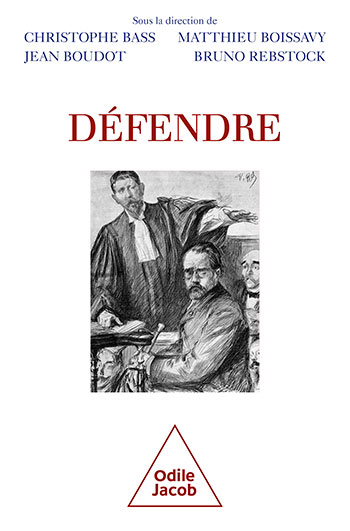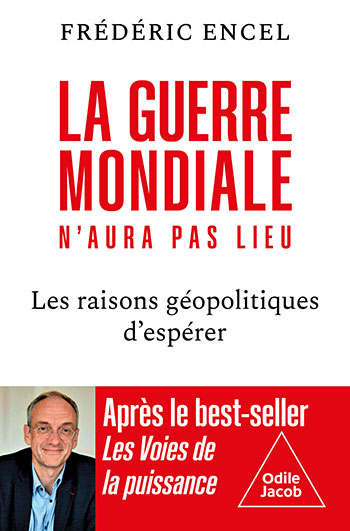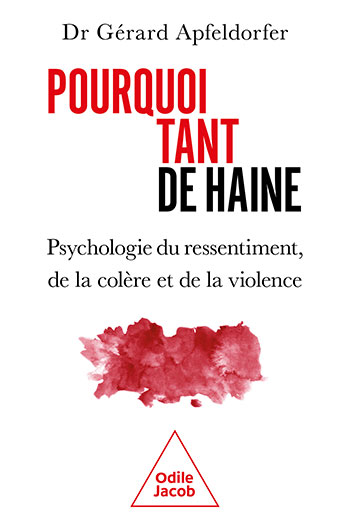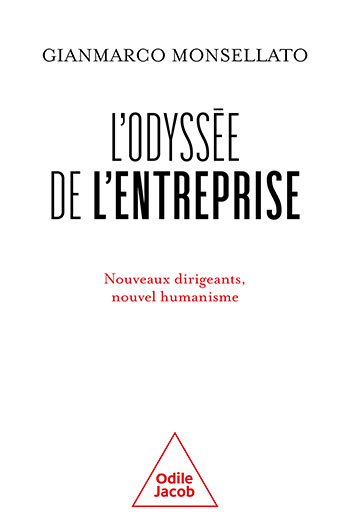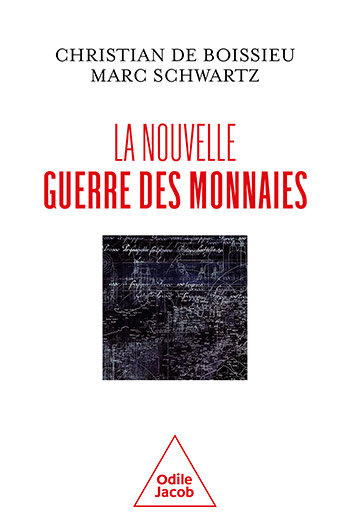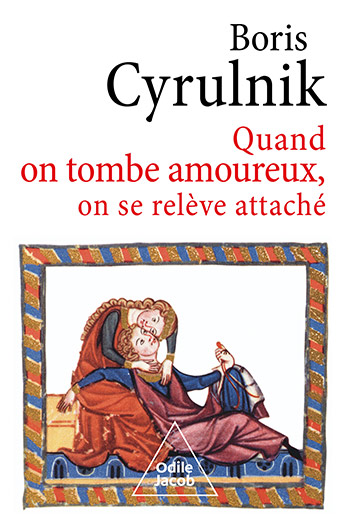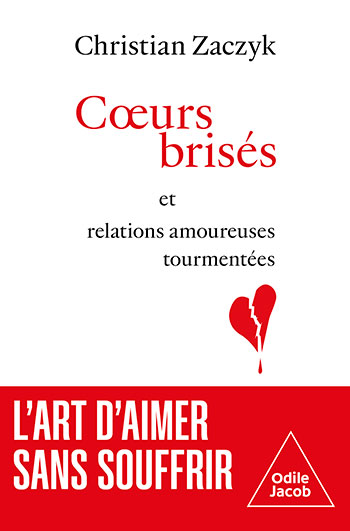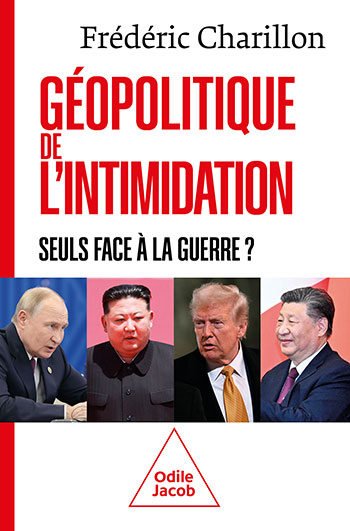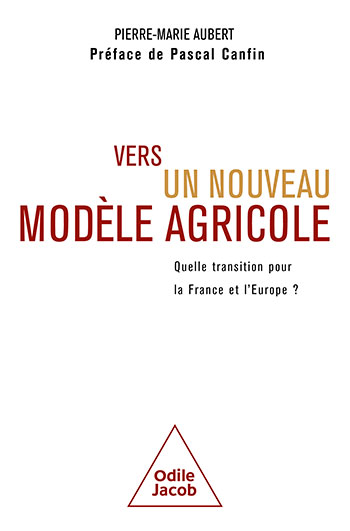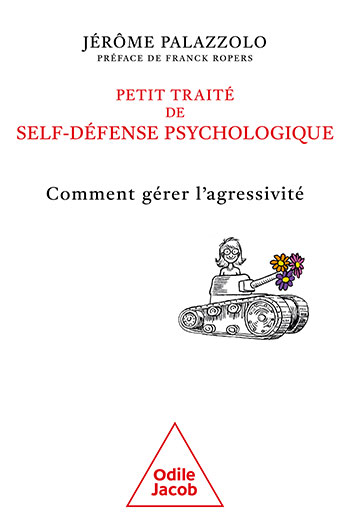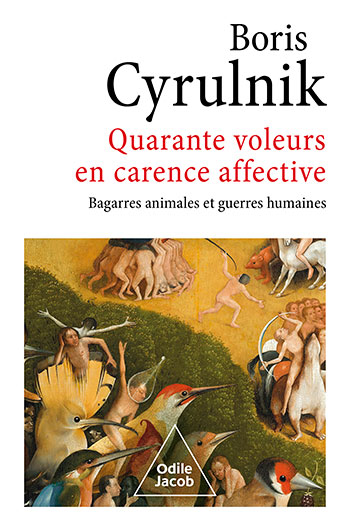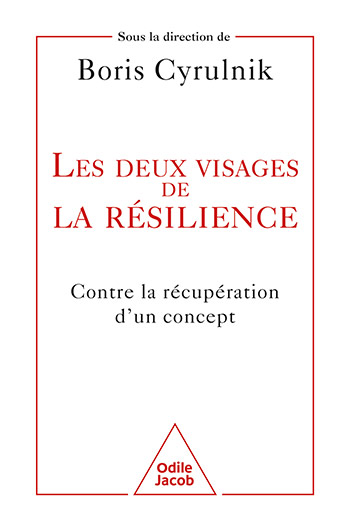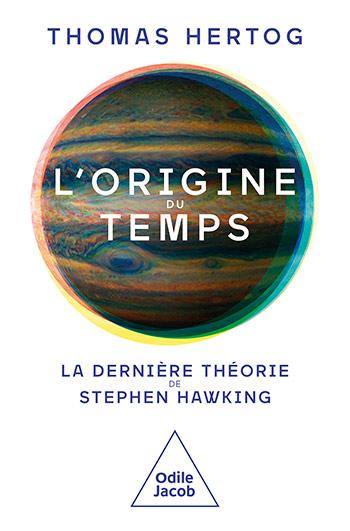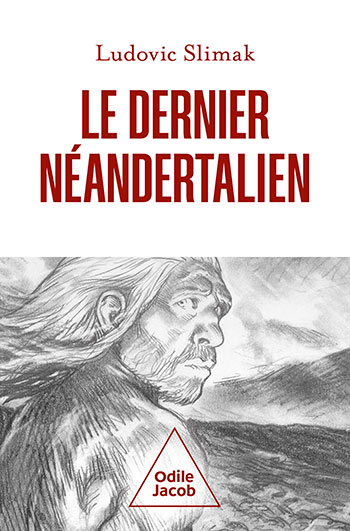Au début de la pandémie du coronavirus, le pouvoir politique a tout naturellement consulté ceux qu’il nommait collégialement « les scientifiques ». Mais, comme je l’ai si souvent constaté au cours de ma carrière située à l’interface du monde politique et du monde scientifique, il l’a fait dans un état d’esprit qui ressemblait alors à s’y méprendre à celle d’un antique général romain interrogeant les augures. Dans ce premier temps, il sembla que le pouvoir politique, sans être encore suffisamment outillé pour peser par lui-même les éléments de jugement qu’il ne maîtrisait pas, transférait à un comité scientifique un pouvoir de décision politique qui n’était pas de son ordre et qui risquait de se retourner contre lui.
Ceci d’autant plus qu’au sein de la communauté savante, les cliniciens et les épidémiologistes étaient loin d’être unanimes. Les plus chevronnés d’entre eux, souvent spécialistes par ailleurs de la médecine tropicale, avaient pourtant fait front à d’autres épidémies meurtrières et inédites en leur temps, en particulier celles du VIH et du virus Ebola. On savait qu’en termes d’excellence, les écoles françaises d’épidémiologie sont parmi les meilleures du monde.
Mais pour expliquer son art subtil et singulier, l’épidémiologiste surtout s’il était aussi clinicien penché au chevet du malade, se trouvait démuni devant un interlocuteur politique qui ne parle pas le même langage que lui. En France l’interdisciplinarité est rare. On oublie que, dans le domaine du vivant, le chercheur est par définition quelqu’un qui s’interroge, qui cherche et compose avec des marges d’incertitude. À l’inverse, les responsables politiques dont la formation administrative, juridique et financière se doit d’être de premier ordre ont rarement manié les notions les plus élémentaires des méthodes fondées sur la logique des probabilités à l’usage des biologistes et des médecins. Or, ces méthodes statistiques fiables et informatisées comportent toujours une marge d’erreur identifiée. Voilà pourquoi un résultat n’est pas forcément transposable d’une population à une autre, d’une situation à une autre, ni à chaque cas singulier. Dans chaque circonstance, tout dépend in fine de la marge de risque jugée acceptable par le pouvoir politique. Dans chaque cas, des critères mesurables, mais aussi des critères humains privilégiés conjointement par le médecin et par le patient. Voilà pourquoi, même les plus prestigieux des patrons réunis en comités ne sont pas toujours unanimes dans leurs jugements lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets indésirables, cumulés ou collatéraux de choix X ou Y ou de l’absence de choix.
Il faut avoir enfin fréquenté le milieu scientifique pour savoir à quel point les immunologistes, les virologues et les épidémiologistes ont chacun leur grammaire et leur vocabulaire créolisé d’anglicismes, d’abréviations et de grec ancien. Ceci, au point qu’ils ne se comprennent pas toujours entre eux, et a fortiori ne comprennent pas pourquoi on ne les comprend pas hors de leur tribu.
Fondation Charles de Gaulle : dans ces moments où le dialogue entre le politique et le scientifique peut conduire à des contresens, en quoi le souvenir du général de Gaulle peut-il nous être précieux ?
Dans la crise sanitaire actuelle, nul ne sait ce qu’aurait fait ni ce qu’aurait dit le général de Gaulle. Pas plus que nous ne savons ce qu’il aurait dit et fait à l’époque où débuta la révolution de l’intelligence artificielle. Nous ne pouvons l’imaginer armé des smartphones et de tablettes, lui qui confinait sous l’escalier de son entrée l’unique téléphone de la Boisserie. Le Général appartenait à la génération technique de l’armement lourd, de l’atome et de l’espace.
Mais s’il était visionnaire, c’est qu’il appartenait surtout à la génération de la volonté d’excellence et de la résistance à la médiocrité. Dans le domaine médical qui nous préoccupe aujourd’hui, c’est avec lui, que dès 1958 furent créés les premiers Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et qu’en 1964 fut fondé l’Institut National de la santé et de la recherche médicale. Plus tard, en 1995, la volonté de maitriser le grand séquençage du génome et de ne pas en laisser le monopole à d’autres fut encore affirmée dans ce sillage.
Quelles que soient les circonstances, en effet, le Général nous a toujours enseigné que, face à l’inconnu l’aventure exigeante de la recherche est politiquement beaucoup plus fédératrice que l’affirmation de certitudes érigées au rang de croyances héritées de temps révolus. Plus que quiconque, il a cru aux vertus spirituelles de l’invention, de la résistance à l’ennemi, de la participation de chacun aux responsabilités et de l’action solidaire. C’est exactement ce que nous voyons de meilleur aujourd’hui.
Ce que nous savons enfin – Alain Peyrefitte nous l’a souvent dit dans son inoubliable « C’était de Gaulle » – c’est qu’en secret, le Général, fils de professeur, savait être pédagogue. Ceci d’autant mieux qu’il ne craignait pas d’être pédagogue de lui-même. Ceci, avec une rigueur, une modestie qui étonnait, et son entourage, et ceux qu’il choisissait pour s’instruire. Par nature sa formation militaire était interdisciplinaire : technique, scientifique et active, mais aussi historique et littéraire. Dans les domaines qu’il jugeait émergents et stratégiques, il s’informait mais ne s’en contentait pas. Sa mémoire légendaire était travaillée. Avant d’adhérer, il exigeait de comprendre. De déceler par observations répétées celles qui apparaissaient constantes, pertinentes, adéquates. A plus de 70 ans, il n’hésitait toujours pas à s’armer d’outils intellectuels nouveaux. Alors, il analysait les procédures, les rythmes de progression, les particularités des terrains, les cas particuliers. Il se taisait longtemps. Puis, comme un médecin, parfois comme un chirurgien, comme un chef en tout cas, il diagnostiquait et opérait.
Alors seulement, il prenait la parole pour convaincre. Parfois le pittoresque de ses images semblait jaillir de source. Mais il était étayé par une culture qui venait du fond des âges français et n’était pas d’emprunt. Il provoquait le contraire du glissement. Il exigeait le ressaisissement.
N’essayons pas d’imaginer les ordres qu’il nous aurait aujourd’hui donnés. Nous les ignorons. Faisons plutôt confiance à l’irrésistible ironie avec laquelle il nous aurait indiqué les disproportions ou les exagérations, les négligences ou les ignorances acceptées ; en somme, les pistes impraticables ou descendantes. Sous son égide, la génération politique actuelle, si jeune fut elle, a tout pour trouver sa meilleure voie. En effet, dans les mois à venir et pour tous les responsables politiques, le maître mot sera : « apprendre ».
Élisabeth Dufourcq, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique et secrétaire d’État à la Recherche, est inspecteur général des Affaires sociales honoraire et membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Docteur en sciences politiques avec HDR et DEA en santé publique et pays en développement, ancien ingénieur de recherche à l’Inserm, elle enseigne une introduction à l’histoire des sciences à l’Institut catholique de Paris et à l’Association philotechnique de Paris.
Dernier ouvrage publié aux éditions Odile Jacob : L’esprit d’invention – Le jeu et les pouvoirs (mai 2018)
Entretien initialement réalisé et publié par la Fondation Charles de Gaulle.