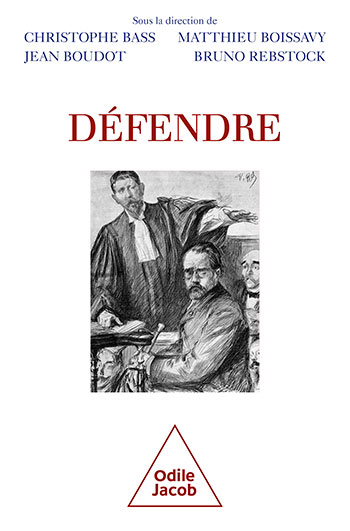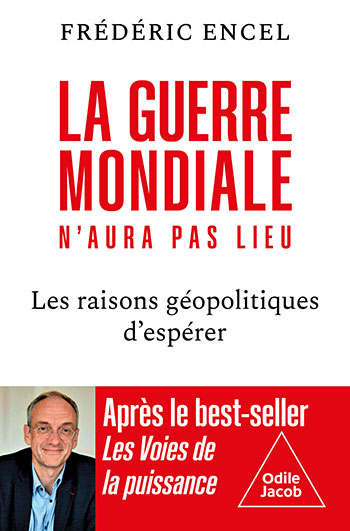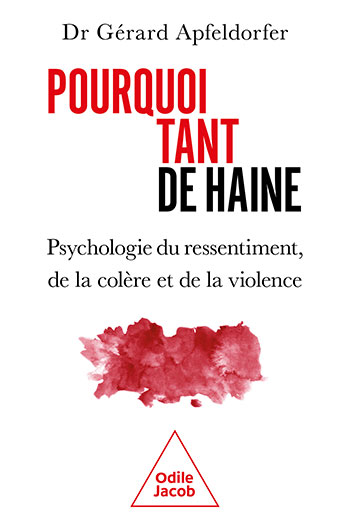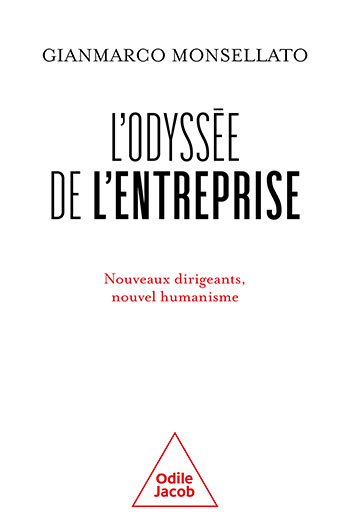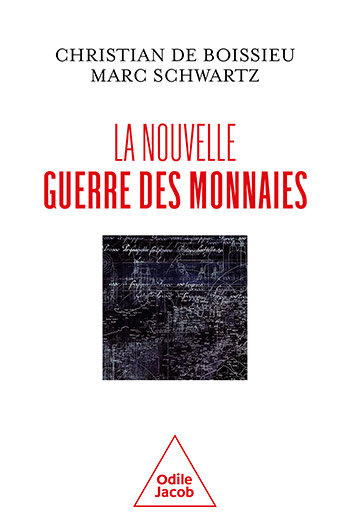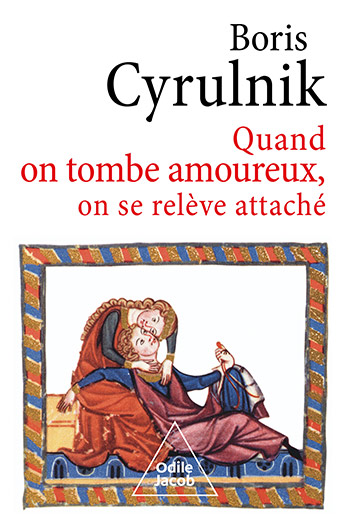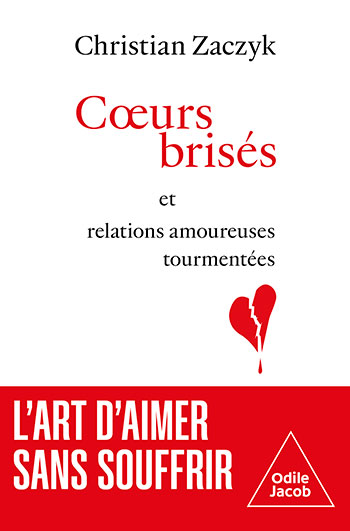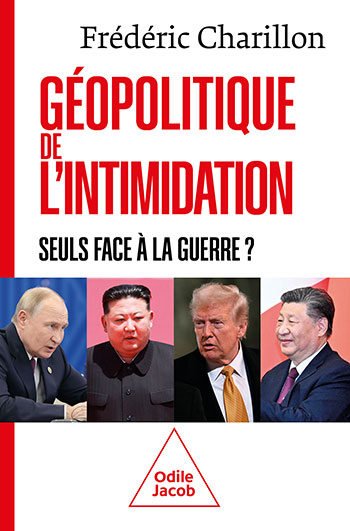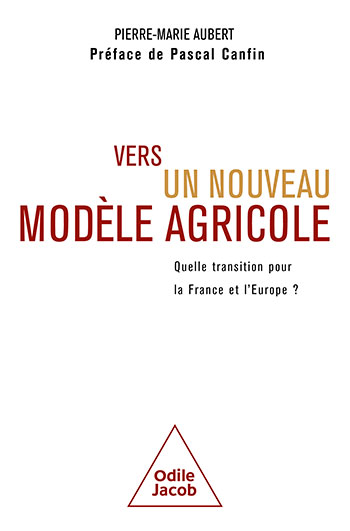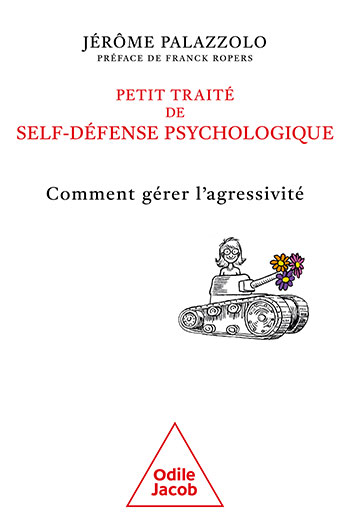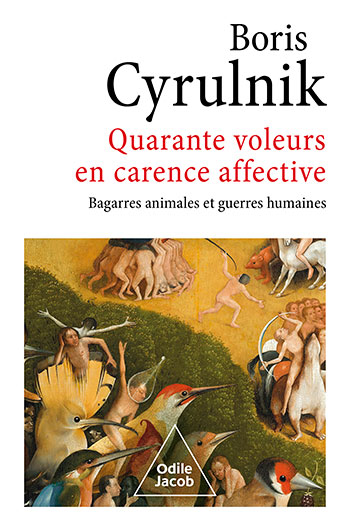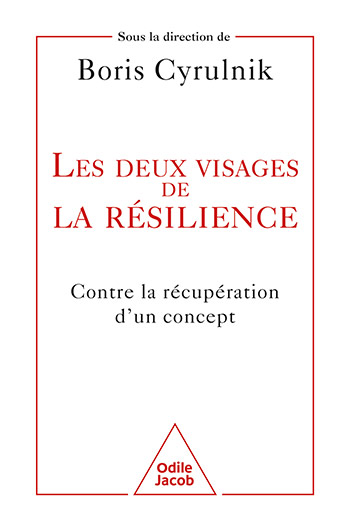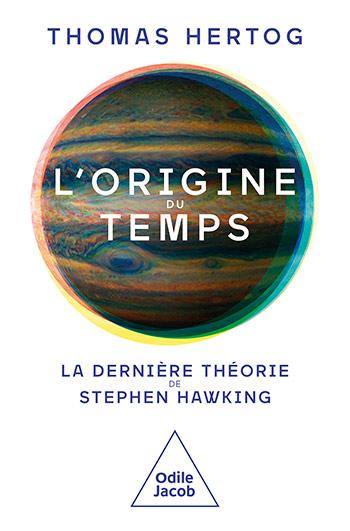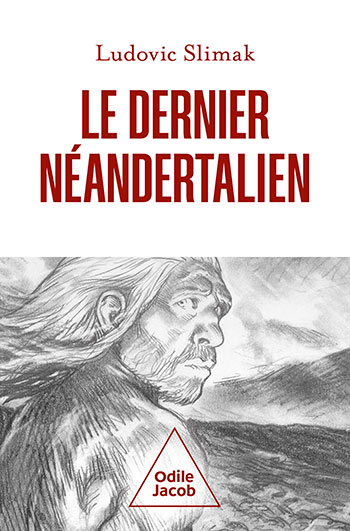La diversité des réponses nationales à la pandémie de Covid 19, qu’il s’agisse des modes de gestion de crise ou de leur efficacité en termes de nombre de morts, est extrêmement frappante. Deux mois après les premiers cas, il y avait environ 100 fois plus de morts par million d’habitants en Grande Bretagne, en Italie et en Espagne qu’en Corée. Avec le même mode de gestion, le confinement massif, les différences de mortalité entre pays européens ou avec la province du Hubei en Chine et les Etats Unis, sont tout aussi frappantes.
C’est que ces résultats relèvent de bien autre chose que de l’imprévoyance de certains gouvernements, du nombre de lits de réanimation et de l’état initial des stocks de masques et de tests. La gestion d’une crise sanitaire de cette ampleur engage la société toute entière. Certes, d’abord l’organisation des Etats, la hiérarchie des pouvoirs, centraux, provinciaux, locaux, l’adaptabilité des chaines de commandement et de responsabilités, mais tout autant le comportement des gens, leur conception des libertés individuelles, l’intensité des solidarités spontanées, et jusqu’à la réactivité des entreprises privées.
La crise économique provoquée par la pandémie, qui ne fait que commencer, est comme elle absolument inédite. En apparence, l’arsenal des mesures gouvernementales est le même que celui utilisé et bien rodé lors de la crise de 2008. Mais en réalité, les réponses sont tout aussi inédites et différenciées que les réponses à la pandémie. En Europe et encore plus aux Etats-Unis, les règles antérieures des politiques budgétaires et monétaires sont rayées d’un trait de plume. Les déficits publics explosent, car les gouvernements soutiennent la demande « quoiqu’il en coûte » en distribuant des milliards de « monnaie hélicoptère » sans passer par les banques. Quant au financement par création monétaire des dettes publiques, il n’est désormais plus tabou. En Europe, ce consensus risque fort cependant de ne pas durer et l’Allemagne pourrait revenir à une plus stricte orthodoxie, mettant ainsi l’euro en grave danger. En revanche, ce genre de mesures n’est pas à la portée des pays pauvres, et la Chine, comme dans bien d’autres domaines, a des marges de manœuvre qui lui sont propres.
Ces deux crises, avec leurs réponses nationales si différentes, sont pour toutes les organisations de la société une mise à l’épreuve radicale de leur capacité à anticiper et à gérer des situations exceptionnelles. Elles inaugurent sans doute l’émergence d’une nouvelle « vision » d’ensemble du cours de l’histoire.
Culture du risque, vision stratégique et gestion de crise.
Ces crises devraient en effet profondément transformer la perception, par les gouvernements et les populations, de la nature des risques extrêmes, de leur probabilité d'occurrence et des moyens d’y faire face. On va d'ailleurs probablement passer dans ce domaine d'un excès à l'autre. De l'insouciance généralisée, malgré les avertissements des savants : « ça n'arrivera pas de mon vivant » ou : « ça n’arrivera qu’aux autres » à l’angoisse mortifère que traduisent aujourd’hui les idéologies de « l’effondrement ». Ou les fantasmes anthropomorphiques selon lesquels une « nature » personnifiée, la déesse Gaïa, se vengerait cruellement d’une espèce, homo sapiens, qui commençait à trop l’importuner.
« Vivre avec » des risques extrêmes
Il reste incontestable que la liste des risques extrêmes s'allonge et que leur probabilité d’occurrence augmente.
Risques sanitaires, évidemment. Avec des pandémies virales de toutes sortes devenues aussi fréquentes que celles de la grippe annuelle. Avec des virus synthétiques, dont certains finiront bien par s'échapper des laboratoires. Enfin avec la destruction de la forêt primaire, si elle continue, et la fonte du permafrost qui selon les scientifiques vont « débusquer et libérer des monstres extrêmement dangereux. »
A quoi s’ajoutent bien sûr tous les risques de catastrophes naturelles liées au changement climatique : sécheresses, incendies gigantesques (Californie et Australie récemment), inondations, tsunamis, ouragans et tempêtes tropicales, sans parler de El Nino qui se détraque et du Gulf Stream qui s’arrête.
Mais il ne faudrait pas négliger, contrairement à ce qu'affirmait Bill Gates dans sa désormais célèbre conférence prémonitoire de 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&t=16s), les risques de guerre nucléaire. D’abord les accidents dans l’usage des armes atomiques stratégiques. Selon Jean-Pierre Dupuy (« La Guerre qui ne peut pas avoir lieu. Essai de métaphysique nucléaire ». Desclée de Brouwer. 2019), nous n’en serions pas passés loin à plusieurs reprises depuis 1945. Pour ce philosophe, qui pourtant alerta très tôt sur les risques climatiques, la guerre nucléaire est aujourd’hui le risque majeur. Sans aller jusqu’à une guerre mondiale, il existe des risques d'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans les conflits régionaux et d’armement biologique et nucléaire d'organisation terroristes.
Je ne peux m’empêcher de citer, pour relativiser un peu ce qui précède, un autre risque, le risque astronomique. On sait depuis Raymond Poincaré, mais Newton s’en doutait déjà, que le système solaire n’est pas stable. La probabilité n’est pas nulle, quoiqu’infime, qu’un jour la Terre entre en collision avec Mars ou simplement avec un astéroïde géant. On le verra venir, ce sera magnifique, mais ce sera la fin. Car rien ne sert d’imaginer qu’on le détournera de sa trajectoire en le bombardant d’ogives nucléaires. La quantité d’énergie nécessaire est hors de notre portée.
Enfin, naturellement les risques associés à des « Black Swan », des évènements par définition imprévisibles et que l’on ne peut par conséquent pas « probabiliser » (Nassim Nicholas Taleb. « The Black Swan ». Traduction française : « Le cygne noir. La puissance de l’imprévisible ». Les Belles Lettres. 2014.)
Deux régimes très différents
Il nous faut désormais adopter une vision d’un monde où alterneront, avec une fréquence probablement croissante, deux régimes très différents. Le régime « normal », « Business As Usual », gouverné par les tendances lourdes (analysées dans l’article : La « démondialisation », unique horizon du « monde d'après » ?) et des périodes, plus brèves, de crises violentes.
Il faut donc que les principaux organes du pouvoir, en premier lieu les États mais aussi les grandes entreprises, développent une « culture du risque » constituée, d’une part de l’élaboration et de la révision permanente d’une vision stratégique et d’autre part de la mise en place d’organisations spéciales de gestion des crises. Mais il faut d’entrée reconnaître qu’une vision stratégique n’est utile et donc accessible qu’à des organisations dont l’horizon (la durée d’exercice de leur pouvoir) est long.
Qui est capable d’une vision stratégique ?
Or l’horizon des gouvernements élus ne dépasse guère cinq ans, dix si la constitution le permet. Il est plus long pour les organisations capables de se maintenir au pouvoir bien plus longtemps. Il est clair aujourd’hui que le Parti Communiste Chinois se montre capable, dans sa politique de puissance et de développement de la Chine, d’une vision stratégique hors de portée semble-t-il des gouvernements démocratiques occidentaux. Ce n’est pas la moindre des séductions qu’exerce aujourd’hui ce modèle, y compris chez beaucoup de ceux qui, il y a peu, ne juraient que par « les droits de l’homme ».
Du coté des entreprises, il n'y a strictement rien à attendre des banques et des autres institutions financières. Cela peut sembler paradoxal, puisque l'analyse des risques de leur portefeuille d’actifs constitue leur quotidien ou que les fonds de pension investissent aujourd’hui pour payer des retraites 40 ans plus tard. Mais dans tous les cas, il ne s’agit que de gestion de risques de très court terme, car le concept central est ici celui de « liquidité ». une institution financière conserve un actif -d’autant plus rentable en principe qu’il est risqué- tant qu’elle peut s’en débarrasser en moins d’une seconde, donc s’il est « liquide ». Ainsi, comme le disait si bien Charles Prince, l’ex-patron de Citi, « tant que la musique joue, il faut danser ». La finance est intrinsèquement « court-termiste » et n’a aucun intérêt à développer une vision stratégique.
Il n’en est pas de même des grandes entreprises de l'industrie et des services. Elles immobilisent des quantités considérables de capital dans des infrastructures et des machines, mais aussi et surtout dans des ressources humaines qu’elles forment et entraînent, ainsi que dans la recherche technique. Elles ont donc incontestablement un horizon beaucoup plus long que les institutions financières. Elles peuvent et ont intérêt à développer une vision stratégique du monde à venir. Shell et BP, par exemple, ont été pionnières dans l’usage des scénarios de long terme. On peut même penser que c’est parce qu’elles anticipaient en réalité mieux que d’autres le changement climatique, qu’elles ont à ce point tenté, au moins dans un premier temps, d’en nier la réalité.
La première dimension de la culture du risque est donc que les États et grandes entreprises se dotent de cellules d'analyse stratégique des risques (construction de scénarios, évaluation de leur probabilité, conception des moyens de faire face) et que ces cellules soient indépendantes du reste de l'organisation et rapportent directement à la direction.
S’agissant des gouvernements démocratiques, on a dit qu’ils étaient fort peu « stratégiques ». C’est pourquoi ils doivent déléguer cette fonction à la société. Et c’est ainsi qu’ils pourront, fort heureusement, compenser leur désavantage apparent en la matière vis à vis des gouvernements autoritaires.
En effet les seuls agents ayant vraiment intérêt à une vision stratégique sont les individus eux-mêmes, dont l’horizon est au moins leur vie entière et au-delà, celle des leurs enfants. Il ne s’agit donc que d’organiser l’expression de leurs préoccupations pour le long terme.
Les gouvernements doivent donc instituer des organisations indépendantes d’analyse stratégique des risques qui leur rendent compte, mais rendent compte aussi à la société dans son ensemble. Ces organisations doivent fonctionner de manière observable par tous et sans rien cacher, mais au contraire en portant au débat public, les incertitudes et les divisions entre savants. Le GIEC fonctionne ainsi. Il faut créer l'équivalent pour l'ensemble des risques sanitaires. Quant aux risques de guerres, les militaires ont normalement des cellules de ce type. Mais il conviendrait que leurs analyses soient elles-aussi soumises au débat public. La manière dont une nation se « prépare à la guerre » (si vis pacem, para bellum) n’a aucune raison de rester confidentiel. Bien au contraire, cela contribue à la dissuasion de l’ennemi potentiel, au demeurant toujours bien informé par ses services de renseignement. Il aurait été, par exemple, à mon avis bien préférable que le gouvernement et surtout le peuple japonais aient été informés en grand détail des effets terrifiants de la bombe A que leur préparait en grand secret le programme « Manhattan ». Il n’est pas certain que l’armée impériale japonaise aurait pour autant capitulé aussitôt, mais on ne le saura jamais.
S’agissant des grandes entreprises, l’analyse des risques qui les concernent directement comprend évidemment une part confidentielle qui ne peut être divulguée sans mettre à mal leur position concurrentielle. Néanmoins, il serait bien venu qu’une partie en soit également versée dans le débat public, quand les risques concernés ont un caractère général.
Organisations de crise
La crise sanitaire actuelle, au delà des différences de modes de gestion soulignées ci-dessus, a amplement démontré qu'une organisation efficace en temps « normal » a peu de chance de l'être en période « de crise ». C’est particulièrement vrai des administrations publiques, que les routines, les précautions de toute sorte, les nécessaires concertations avec les acteurs de la société, les hiérarchies et chaines de commandement bureaucratiques, rendent assez peu capables de réactions rapides et appropriés. Mais les grandes firmes, qui sont de grands paquebots virant de bord lentement, ne sont pas en reste.
Le second volet d’une « culture du risque » consiste donc à concevoir, préparer à l'avance et entraîner des « organisations de crise », caractérisées par des chaines de commandement courtes, une responsabilité claire et assumée des chefs, s’affranchissant provisoirement des procédures de concertations « démocratiques » lourdes, parfaitement légitimes en période « normale », mais handicapantes en période de crise. A condition évidemment de revenir à la « normale » aussitôt la crise passée. Ce qui n’est probablement pas si facile, comme en témoigne l’inscription dans le droit commun de certaines restrictions des libertés publiques adoptées, « à titre exceptionnel », après les attaques terroristes en France.
Pour que les organisations de crise soient efficaces une fois la crise advenue, alors qu'elles sont en sommeil dans le mode normal, il faudra imaginer et organiser périodiquement quelque chose d'équivalent aux « grandes manœuvres » chez les militaires.
Pierre-Noël Giraud est professeur d’économie à Mines-ParisTech-PSL et à l’Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc.
Dernier ouvrage publié aux éditions Odile Jacob : L’homme inutile – Une économie politique du populisme (janv 2018)Téléchargez l'article