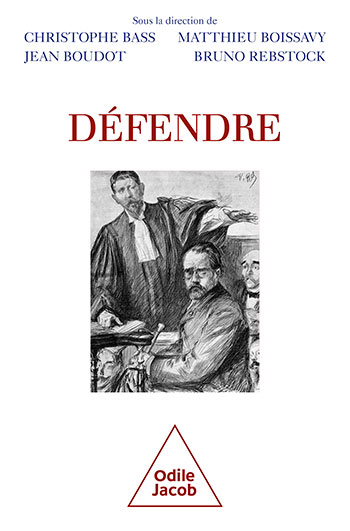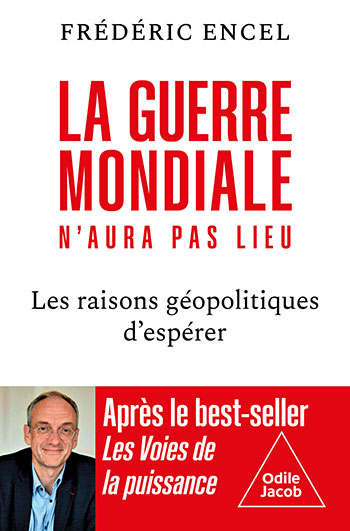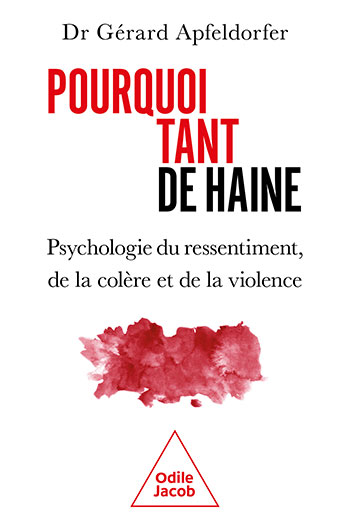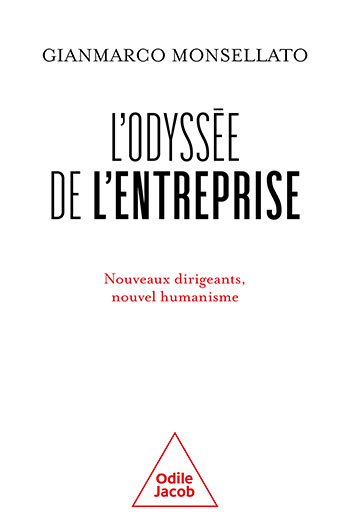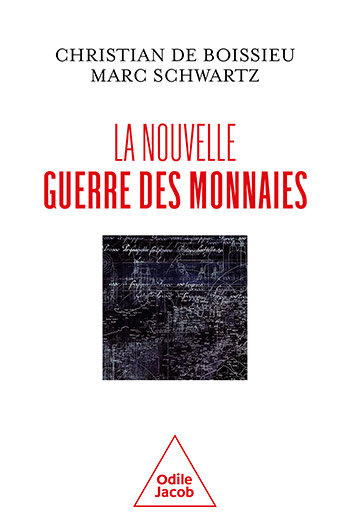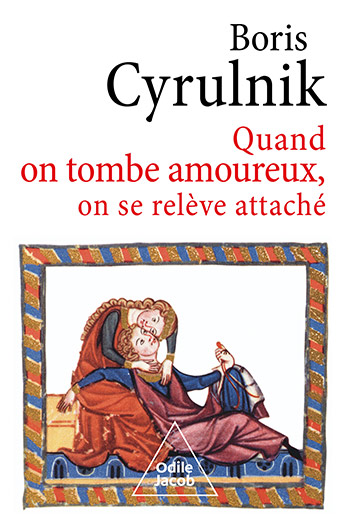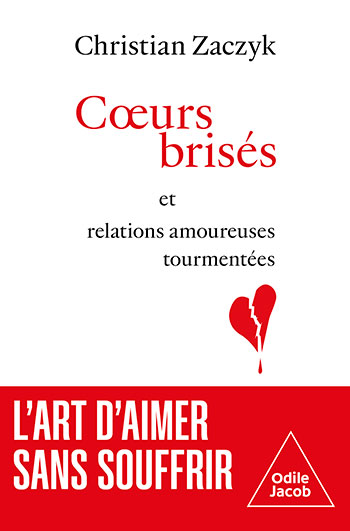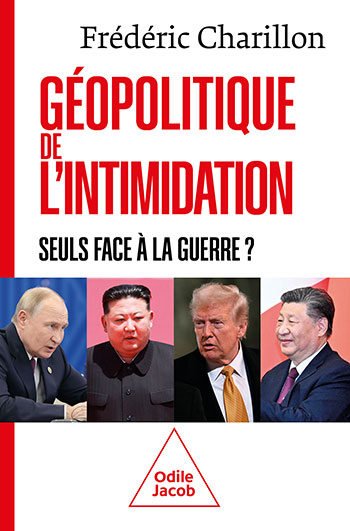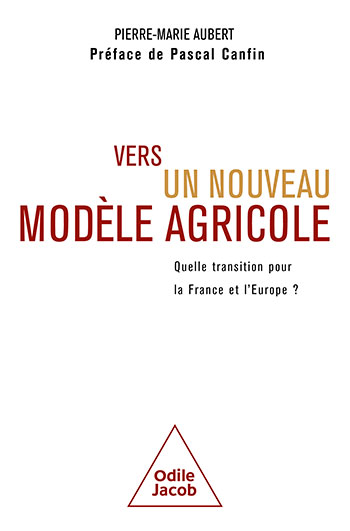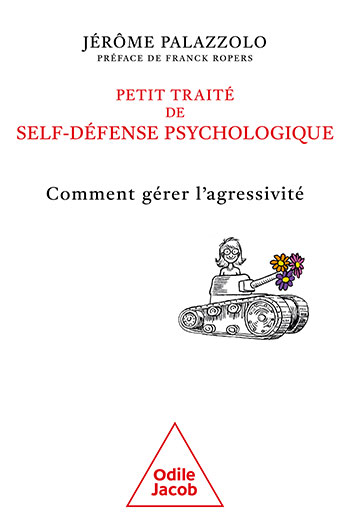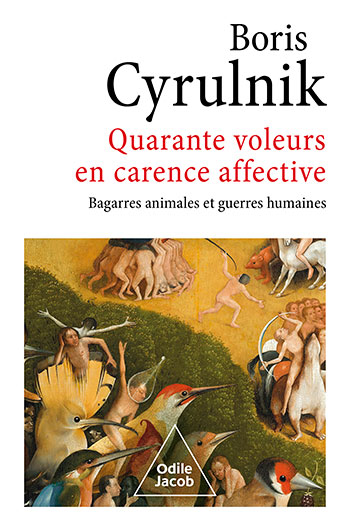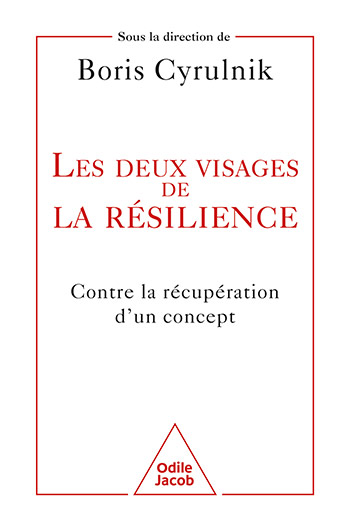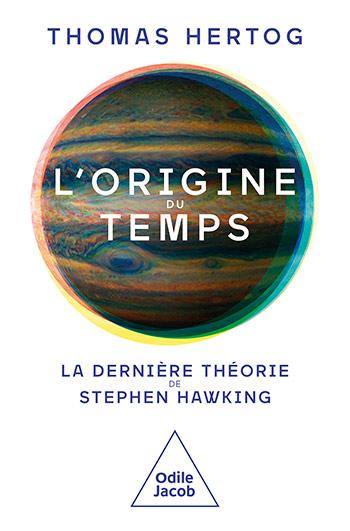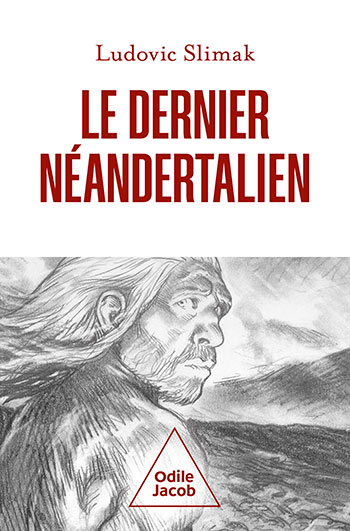LA MONDIALISATION, COUPABLE MUETTE… OU INDIFFÉRENTE
Le choc planétaire du coronavirus appelle une méchante fée dissimulée derrière le berceau d’une humanité innocente et lui jetant un mauvais sort. La mondialisation s’impose d’emblée comme la plus sinistre des marâtres, voulue, façonnée par les Davos Men dans leurs chalets-forteresses. Comme n’importe quelle représentation du monde, la mondialisation se prête à toutes les interprétations, manipulations et perversions possibles. Tel est le destin de toutes les idées, des plus généreuses aux plus oppressives : à peine semées, elles sont vouées à être remodelées par tous ceux qui s’en emparent et les mettent au service de leurs ambitions ou de leurs aigreurs. Hélas, pour les prophètes de l’apocalypse, la mondialisation n’est pas et ne peut pas être une personne que l’on bat, martyrise et finalement extermine.
La mondialisation, ou humanisation de la terre, commence dès la sortie d’Afrique de nos lointains ancêtres à la recherche de territoires pour se nourrir et se reproduire. La mondialisation n’est que l’appropriation sans cesse reprise par les hommes de la terre, notre maison… de hasard, notre précaire refuge, ou notre prison… si nos dogmatismes l’emportent. La mondialisation n’est portée par aucun but, charriant le pire et le meilleur. Surtout elle est irréversible.
La dernière (pour le moment) vague de mondialisation, celle de la seconde moitié du XXème siècle, a pour moteurs les deux mêmes dynamiques millénaires se stimulant l’une l’autre : poussées démographiques, celle des derniers soixante-dix ans ayant une ampleur unique du fait des améliorations de l’hygiène et de la médecine : en 1950, 2,5 milliards d’habitants ; en 2020, autour de huit milliards) ; simultanément accroissement vertigineux des capacités d’exploitation de la terre (avènement de l’anthropocène, l’âge de l’homme maître absolu de la nature –il peut le dire, ajouterait, le doigt levé, le fakir de Châlons-sur-Marne, le regretté Pierre Dac-). Les lames de fond de la longue histoire sont portées par l’intensification des échanges, des circulations –d’abord des hommes-. Au XVème-XVIème siècles, la modernité se met en marche sous la combinaison de l’effervescence multiforme et sanglante de l’Europe et de son ouverture des continents tant par le canon, les marchands conquérants que par les Évangiles. Blaise Pascal nous enseigne que le malheur de l’homme vient de son incapacité à demeurer enfermé dans sa chambre. Sartre, avec son mauvais esprit, remarque que l’enfermement, c’est l’enfer. Les hommes savent ou sentent que leurs flux innombrables et leurs liens enchevêtrés ont rendu la terre minuscule. Il leur faut vivre et assumer cette contraction de l’espace et du temps. Alors bâtir des murs ? Organiser cette explosion des circulations ? S’inventer de nouveaux infinis ?
L’humanité du XXIème siècle, brutalement accrue en quelques décennies, déjà guettée par le vieillissement, entassée dans des agglomérations plus ou moins planifiées, ne peut que continuer à s’accrocher à son pari prométhéen ou faustien : battre la Fatalité ou les dieux par la science et la technique, tout en n’oubliant jamais que ses victoires ne sont que provisoires et ne doivent jamais l’enivrer.
La mondialisation a toujours été et demeure plus que jamais un processus global, économique, social, culturel mais aussi politique et institutionnel. Depuis 1945, en interaction avec l’augmentation massive du commerce, des investissements, des opérations financières, jamais l’humanité n’a autant travaillé pour se doter de structures planétaires. Aurions-nous une vision globale des pandémies sans les administrations de la santé, les États, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ? Les pandémies, inhérentes à la multiplication des hommes et à leur nature sociale, se répéteront. Chacune de ces pandémies relance la formidable machine tant scientifique, médicale mais aussi institutionnelle, juridique... Mais aussi ces remarquables avancées produisent sans cesse de nouvelles demandes : pourquoi ne pas avoir anticipé le choc ? pourquoi ne pas guérir plus vite ? D’abord et toujours critiquer ce qui ne va ou n’irait pas !
SI NOUS SOMMES EN GUERRE…
Mal nommer les choses, c’est augmenter la misère du monde. Cette célébrissime formule d’Albert Camus nous rappelle que les grands mots –guerre, paix, liberté, égalité…- sont des barils de nitroglycérine, que l’on manipule à ses risques et périls. En 2001, l’attaque du World Trade Center de New-York conduit le président George W. Bush à déclarer la guerre contre le terrorisme. Bilan temporaire et très partiel : deux enlisements désastreux en Afghanistan et en Irak ; la prolifération du terrorisme, monstre protéiforme se fragmentant à l’infini comme des personnages de films d’horreur.
Le terme « guerre » a été posé pour le coronavirus. Appuyons-nous sur lui ! Les guerres sont des affrontements à mort entre des « imaginaires » : nation contre nation, croyance contre croyance, idéologie contre idéologie, la survie des hommes ne pesant pas très lourd face aux motifs ou aux ressorts dits nobles : défense d’une « vérité » religieuse, de la patrie. En 1914-1918, des millions de jeunes –souvent les meilleurs- sont tués, nombre de familles perdant trois, quatre fils. Au nom de la patrie, tout est accepté (non sans beaucoup de contournements) : rationnements, famines, et bientôt haines et tortures… Les rares voix à protester contre la boucherie, à saisir la monstruosité dont la Bête est grosse, soit ne sont pas entendues, soit sont dénoncées pour trahison. Un siècle plus tard, la pandémie du coronavirus place, elle, le sauvetage d’une seule vie au-dessus de la préservation d’une économie, déjà irréversiblement déstabilisée tant par la cascade des révolutions technologiques que par les krachs financiers. Les gouvernants, une fois les coûts sans doute insupportables du bouleversement en cours à peu près mesurés, buteront contre les dilemmes tragiques des chefs de guerre : soit maintenir une priorité inconditionnelle pour les impératifs sanitaires, soit reconnaître le caractère vital du maintien des flux économiques mais finalement humains. Il y a guerre, dans la mesure où se heurtent, dans un combat peut-être à mort, deux exigences collectives, l’une mettant la santé individuelle au-dessus de tout, l’autre la poursuite de l’activité. Que survienne une autre pandémie, les États pourront-ils dépenser sans compter ? L’argent, toujours l’argent, nerf de la guerre !
Une guerre oppose des ennemis. Le coronavirus, ennemi de l’homme ? Est défini comme ennemi un autre homme (ou une construction humaine, comme un État) perçu comme une menace réelle… ou parfois imaginée ou au moins exagérée. Le coronavirus doit-il et peut-il être assimilé à une entité politique soutenue par une volonté construite de vaincre et de dominer ? Ne faut-il pas toujours se méfier de l’anthropomorphisme, le coronavirus ou très vite nombre d’autres « virus » pouvant être aisément dénoncés comme les masques ou les costumes d’ennemis invisibles ?
APRÈS, 1984 ? OU UNE NOUVELLE AMÉRIQUE ?
La pandémie du coronavirus confirme que la terre entière, du fait tant des circulations, des réseaux que des bureaucraties emboîtées les unes dans les autres, a été constitué en un espace social et politique unique par des hommes plus ou moins conscients de leur extraordinaire entreprise. Le rétablissement des contrôles de toutes sortes aux frontières ou ailleurs n’empêchera pas les flux invisibles ou clandestins. Les hommes sont plus que jamais actifs ou réactifs aux mesures que les gouvernants s’efforcent d’instaurer pour apparaître comme les maîtres de mystères qui se jouent cruellement d’eux.
La bonne vieille géopolitique subsiste. Traitements et vaccins sont pris dans les compétitions de puissance. La Chine, grisée par son ascension spectaculaire, soudain jetée à terre par un virus venu d’animaux sauvages, ne peut que vouloir être la première à dompter la maladie. Les États-Unis, à la prééminence contestée, réclament, eux aussi, un besoin urgent de victoires. Le choc immédiat plus ou moins passé et surmonté, viendront les bras-de-fer féroces sur l’organisation de notre planète. Le repli, l’enfermement signifient l’appauvrissement, le déclin. Les deux colosses –États-Unis, Chine- peuvent-ils prospérer et garder une forme de puissance sans un système d’échanges aussi interactif que possible ? Quant à l’Europe, la voici seule… comme elle le fut dans les années 1930. Cette fois-ci, l’URSS et les États-Unis ne la sauveront pas. Les Européens se prosterneront peut-être, comme le font déjà certains d’entre eux, devant le dernier empereur de Chine. Juste oscillation de l’histoire ?
Dans le cadre mondial, l’ouverture ne se séparera pas d’une surveillance de plus en plus systématique et étouffante des sociétés, des individus pour le plus légitime des motifs, la santé de tous. Le corps médical comme nouvelle Inquisition ? 1984, Big Brother au bout de la route chaotique de la mondialisation ? Mais peut-être, devant nous, se profilent, encore cachés dans le lointain, des continents inconnus, comme le fut l’Amérique pour les Européens des XVème-XVIème siècles. L’avenir ne sera pas rose, il ne l’a jamais été, des Indiens seront massacrés, des Africains réduits en esclavage mais l’avenir sera à nouveau ouvert… vers d’autres horizons, d’autres planètes.
L’homme, exilé du paradis pour toujours perdu du ventre maternel, ne peut échapper à sa condition de Sisyphe, hissant son rocher jusqu’au sommet pour le voir retomber au pied de la montagne… et recommencer. Avancer, avancer toujours, avancer malgré tout. Croire malgré tout au progrès tout en tentant de conserver la sagesse des Grecs conscients qu’il ne sert à rien d’oublier la colère des dieux. Elle sera toujours là, se déchaînant lorsque l’on ne l’attend pas ou plus !
Philippe Moreau Defarges, géopoliticien, dernier ouvrage publié : Une histoire mondiale de la paix, Odile Jacob, 2020.